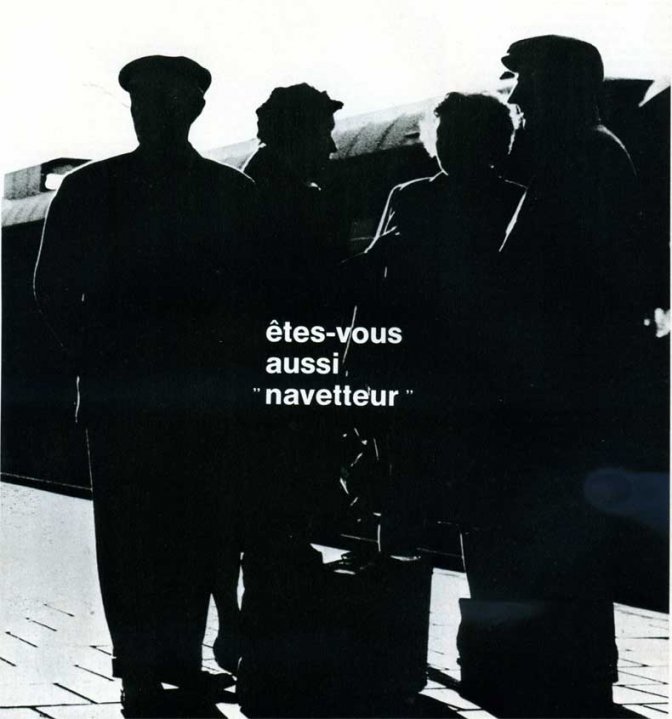Accueil > Le Rail > Société > Etes-vous aussi « navetteur »
Etes-vous aussi « navetteur »
L. Pardon
mercredi 2 janvier 2013, par
Dans un pays où pas mal de gens effectuent quotidiennement le trajet aller et retour entre leur domicile et leur siège de travail, la question pourra paraître sibylline à d’aucuns. Parce que, bien sûr, l’important est de savoir ce qu’on appelle un « navetteur ».
Il arrive que des spécialistes fassent la distinction entre « navetteurs » et « migrants alternants » mais comme cette distinction demeure toute théorique et est sujette à confusions, nous nous en tiendrons à la seule appellation de navetteur, qui, pour être un néologisme, n’en est pas moins compréhensible pour tous.
Le navetteur est donc une personne - ouvrier, employé, etc. - qui exerce sa profession dans une autre commune que celle où il a son domicile et doit ainsi effectuer quotidiennement le trajet aller et retour entre celui-ci et son siège de travail.
Historique
Un rapide coup d’œil sur notre arbre généalogique nous permet, pour la plupart, de constater que nos ancêtres, dans un passé pas tellement lointain, étaient des paysans. Il n’y a pas de quoi s’en étonner. En effet, hormis la noblesse et le clergé, jusqu’au début du XIXe siècle, la majorité de la population active était occupée, d’une façon ou d’une autre, aux travaux agricoles. On peut donc dire que, jusque-là, le métier s’exerçait à l’ombre du logis et ne nécessitait pratiquement pas de déplacement.
D’ailleurs, en ces temps reculés le besoin de voyage se faisait peu sentir : on quittait rarement le village et, si on le quittait, c’était pour se rendre à pied au marché le plus proche, voire avec une charrette attelée d’un chien ou, beaucoup plus tard, d’un cheval.
Cette société campagnarde, sur laquelle on jette parfois un regard nostalgique, engendrait des conditions économiques et sociales souvent intolérables. La richesse d’une minorité s’établissait grâce à l’exploitation du plus grand nombre qui parvenait à peine à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille : le fermage acquitté, il restait peu d’argent pour nourrir les enfants, souvent nombreux. Cette multitude de gosses d’ailleurs allait grossir une main-d’œuvre excédentaire et entraîner par là-même un chômage latent.
Au moment où la première révolution industrielle provoquait, en Belgique notamment, l’essor de quelques secteurs de base de l’économie, tels que le charbon, le fer, l’acier et les textiles, le climat social se modifiait profondément. L’absorption par l’industrie de la main-d’œuvre excédentaire de l’agriculture (d’abord les domestiques, puis les membres de la famille et enfin, beaucoup plus tard, les métayers eux-mêmes) provoquait la naissance d’un prolétariat d’usines qui ne jouissait pas d’un salaire équitable. C’était aussi le temps des travaux lourds pour les femmes et les enfants, des logements insalubres et rudimentaires, de l’absence totale de plaisir à la tâche, conséquence de la dissociation du travail et de la production.
Le désir intense d’établir une législation sociale plus juste, que les circonstances motivaient, conduisit finalement à l’instauration d’un horaire fixe de travail, qui s’échelonnait encore entre 10 et 12 heures par jour à l’époque, à la sécurité de l’emploi, à un revenu fixe et à une forme élémentaire de sécurité sociale. Le transfert du lieu de travail des champs vers l’usine signifiait par le fait même le déplacement de l’ouvrier vers un lieu de travail sensiblement plus éloigné. Au début, ce déplacement s’effectuait à pied, ce qui prolongeait de 2 à 4 heures la durée d’éloignement du domicile. Plus tard, celui qui avait les moyens put s’acheter un vélo afin de raccourcir le temps passé sur les routes. Certains ouvriers de l’industrie cependant préféraient quitter leur terre natale pour aller se fixer dans les environs immédiats de leur lieu de travail.
L’influence des chemins de fer
Suite à la loi du 1er mai 1834 qui portait création d’une société de chemins de fer dans notre pays, notre réseau se développa rapidement et cet essor fut d’un grand intérêt pour les travailleurs qui se déplaçaient tous les jours. Non seulement la distance domicile/lieu de travail fut couverte bien plus vite, mais aussi à moindres frais : les tarifs des chemins de fer, répartis en 4 classes sur la base du confort, tenaient compte des moyens financiers des navetteurs de l’époque. Ainsi, on payait en 3e classe (la plus basse) 2,5 centimes par kilomètre, alors qu’en berline (1e classe/super) le prix était de 12,5 centimes par kilomètre. Le voyage en diligence revenait à 10 centimes au kilomètre. L’abonnement ouvrier fut instauré à la suite d’un arrêté ministériel du 8 septembre 1869 et, dès le 15 février 1870, on pouvait obtenir aux chemins de fer de l’Etat un abonnement à la semaine en 3e classe, valable pour 6 déplacements aller et retour. On était cependant en l’occurrence tenu d’emprunter des trains déterminés (le plus souvent le premier et le dernier de la journée) et la distance ne pouvait excéder 25 km. Pour un tel abonnement, on payait 2 francs.
Plusieurs adaptations, de même que l’instauration d’un abonnement pour un seul déplacement aller et retour par semaine, concoururent à augmenter sensiblement le nombre des abonnés. Entre-temps, d’autres mesures, notamment l’octroi de prêts à des conditions favorables, avaient suscité la construction de maisons ouvrières à travers tout le pays. A ceux qui n’entendaient pas abandonner leur terre natale, l’abonnement à bon marché apporta une heureuse solution puisqu’il leur permettait d’aller travailler loin de leur domicile, là où les salaires étaient plus élevés, sans avoir à renoncer à leur vie de famille ou à se fixer dans des cités industrielles.
Après la deuxième guerre mondiale, et à une cadence plus élevée, le transport privé (auto, moto, pétrolette), de même que les bus de ramassage frétés par l’employeur ont joué un rôle de plus en plus important dans le trafic de navette.
Quelques chiffres
D’après le recensement de 1970, 3,5 millions des 9 650 000 Belges représentaient la population active. Ce chiffre comprenait les ouvriers et les employés, mais aussi les indépendants, commerçants, agriculteurs, artisans et militaires de carrière. Environ 1 900 000 de ces gens exerçaient chez eux leur profession ou dans leur localité et n’étaient donc pas considérés comme navetteurs. Les 1 600 000 restants (soit 45 %) par contre se déplaçaient, le plus souvent quotidiennement, de leur domicile à leur siège de travail situé hors de leur commune.
Comparé au recensement précédent (1961), le nombre de navetteurs s’était accru d’environ 250 000 unités. Malgré cette augmentation, le nombre de personnes qui faisaient la navette en train avait légèrement baissé : 265 000 personnes utilisaient encore journellement le train en 1970, alors qu’elles étaient 280 000 en ’61. La part du transport public dans son ensemble (train + tram + bus) était tombée de 47 à 40 %. Le transport à vélo, vélomoteur ou moto, reculait, lui aussi, alors que l’usage de la voiture personnelle augmentait sensiblement : 43 % des 675 000 navetteurs utilisaient l’auto en 1970 contre 190 000 (14 %) en 1961.
La durée du déplacement entre le domicile et le lieu de travail avait diminué. Quelque 90 % des navetteurs mettaient moins d’une heure (contre 70 % en 1961), mais 10 000 personnes habitaient encore à deux heures de leur lieu de travail. La durée de l’absence du domicile avait donc sensiblement diminué, ce qui rendait la navette plus acceptable du point de vue social.
Deux questions se posent immédiatement, à la lueur de ce qui précède. Comment se fait-il que presque la moitié de la population active faisait la navette en 1970 ? Pourquoi le chemin de fer avait-il perdu de sa clientèle ?
Pourquoi tant de navetteurs ?
Il apparaît d’emblée que le nombre de navetteurs en Belgique est assez élevé, comparé par exemple à celui des Pays-Bas (45 % contre 25 % de la population active).
Cette différence s’explique en quelque sorte par le fait que la Belgique compte un plus grand nombre de communes que les Pays-Bas, de façon absolue comme à l’intérieur même des agglomérations. Chez nous, un travailleur est donc repris plus facilement dans les statistiques en tant que navetteur (voir définition liminaire).
Le bref aperçu historique de tantôt a fait apparaître que la navette est née de l’attrait qu’exerçaient les salaires de l’industrie sur les ouvriers agricoles.
Actuellement, le déplacement de la main-d’œuvre est incontestablement favorisé par des carences régionales, par les différences de niveau de salaires d’une région à l’autre ainsi que par la spécialisation de plus en plus poussée des tâches.
Dans quelques arrondissements tels que Louvain, Waremme, Maaseik, Virton, Termonde, Dixmude, Ath, Thuin, Tongres et Alost, les possibilités d’emploi sont minimes ; ainsi que dans l’ensemble des provinces wallonnes où elles diminuent parce que, d’une part les charbonnages - et quelques industries connexes - ont fortement ralenti sinon stoppé leurs activités et que, d’autre part, il n’y a pas eu de reconversion industrielle importante.
Dans les provinces flamandes au contraire, la navette s’explique entre autres par l’explosion démographique, par la désaffection des professions agricoles et par la périclitation de l’industrie textile.
Sur le plan national, entre surtout en ligne de compte le niveau des salaires pratiqués dans les grands centres, qui est plus élevé que dans les régions excentriques. De plus, beaucoup d’emplois locaux, de par la nature même du travail qu’ils impliquent, sont abandonnés à la main-d’œuvre étrangère, alors que les autochtones s’astreignent à faire la navette pour exercer des tâches plus rémunératrices et plus « décentes ». Un autre facteur qui favorise la navette, c’est la localisation des industries. Signalons au passage que la dépendance économique d’une entreprise - par exemple son implantation à proximité de charbonnages ou de gisements de minerais - se fait moins sentir actuellement en Belgique. En effet l’implantation des nouvelles industries y est influencée, par exemple, par la présence d’une infrastructure de transport efficiente (chemins de fer, autoroutes, canaux, ports), ainsi que par la disponibilité de terrains à bas prix en dehors des zones d’habitation. L’installation d’une industrie du fer et de l’acier sur la côte et la construction de réacteurs nucléaires en rase campagne en sont d’éloquentes illustrations.
A ce sujet, il est bon sans doute d’attirer l’attention sur l’importance de l’aménagement du territoire : une localisation judicieuse des industries par rapport aux zones d’habitation peut, dans une certaine mesure, aider à mettre un frein aux déplacements de la main-d’œuvre.
Il est par ailleurs incontestable que Bruxelles exerce un attrait sur les ouvriers et les employés. Le développement de la capitale en tant que « management-city », la croissance du secteur tertiaire (commerce, banques, assurances. transports) ainsi que l’implantation de grandes entreprises multinationales, de diverses administrations et d’organismes européens procurent d’énormes débouchés. La diminution de la durée des prestations, la généralisation de la semaine de cinq jours, l’option marquée pour la résidence « extra-muros », les problèmes linguistiques ainsi que les salaires élevés qui sont pratiqués dans l’agglomération bruxelloise jouent un rôle prépondérant sur le déplacement de la main-d’œuvre.
Parmi les différents courants, celui qui draine les navetteurs vers Bruxelles est de loin le plus important ; il concerne environ 250 000 personnes, soit 1/4 de la population active : 175 000 viennent des Flandres et 70 000 de Wallonie. On pourrait dire que, dans 97 % des communes du pays, il y a au moins un navetteur qui se rend à Bruxelles. La navette est en principe quotidienne, sauf pour quelques habitants des régions frontalières de l’ouest, du nord et des Ardennes. Toutefois, sans une bonne adaptation des moyens de transport, tous ces facteurs perdraient beaucoup de leur influence.
En effet, une navette souple et la moins contraignante qui soit nécessite des moyens de transport rapides et confortables, répondant aux exigences de la clientèle.
A côté des facteurs d’ordre économique, il y en a un certain nombre à caractère plutôt psychologique qui influencent le problème du déplacement de la main-d’œuvre. Il arrive que la navette soit tellement incrustée dans les mœurs que les travailleurs refusent tout emploi dans leur propre région. Travailler dans un grand centre ou loin de son domicile confère à certains une manière de prestige, encore accru lorsque l’emploi s’exerce dans une administration et garantit la stabilité matérielle.
Pourquoi la navette par train ?
A première vue, la question paraît assez drôle lorsqu’on connaît le caractère particulièrement favorable des tarifs ferroviaires. En effet, les ouvriers et, dans une certaine mesure les employés, sont transportés à des tarifs sensiblement inférieurs aux prix de revient. Ici, donc, sous la poussée gouvernementale, les chemins de fer assument un rôle essentiellement social.

Pour illustrer ce prix de transport avantageux, voici l’exemple d’un ouvrier qui habite à 30 km de son lieu de travail. Eh bien ! pour son abonnement d’une semaine en 2e classe, cet ouvrier paie 200 francs dont la moitié lui est légalement restituée par l’employeur. En supposant que l’ouvrier effectue 5 trajets aller et retour par semaine, il paie réellement 10 francs par parcours de 30 km, soit 0,33 F/km, c’est-à-dire 20 % du prix du billet ordinaire.
Cet avantage social est également accordé, comme cela est dit plus haut, aux employés dont le traitement brut annuel ne dépasse pas le maximum admis par le ministère des Communications, c’est-à-dire 325 000 francs.
Si nous comparons ce prix de 0,33 F/km à celui du kilomètre parcouru par une 5 CV qui effectue 18 000 km par an et qui se situe à 4,32 F/km selon l’AGEFI (L’auto et la route - janvier 75 - page 19), nous constatons que le transport en auto coûte 13 fois plus cher qu’en train.
Dans ce calcul, il n’est même pas tenu compte du coût social de la voiture ni de l’infrastructure qu’elle implique. En général, l’automobiliste tient uniquement compte du coût marginal (frais d’essence et petits entretiens) qu’il supporte dans l’immédiat.
Si l’auto connaît néanmoins du succès chez les navetteurs, cela est dû au progrès sensible du bien-être que le Belge moyen a connu dans les années ’60, qui s’est concrétisé, entre autres choses, par une augmentation considérable du parc automobile : en 1961, il y avait environ 720 000 voitures, en 1971 ce nombre avait presque triplé (2 000 000).
Pendant cette même période, d’énormes sommes - des centaines de milliards - ont été affectées à la construction et à l’amélioration de routes, autoroutes, etc.
L’infrastructure nouvelle et rénovée semblait pour certains propriétaires de voiture être une invitation à utiliser celle-ci pour effectuer leur navette quotidienne. Des accords ont même été conclus entre plusieurs personnes pour se déplacer ensemble en voiture en partageant les frais. L’usage de l’auto fut en outre stimulé par l’habitude contractée par certaines entreprises de supporter aussi une partie des frais de transport des navetteurs utilisant leur voiture. La promotion des transports publics était mise au frigo...

L’implantation des zones industrielles, parfois à l’initiative des Pouvoirs publics, assez loin des lignes de chemin de fer existantes, favorise également l’utilisation de moyens de transport individuels ou d’autobus de ramassage frétés par les entreprises.
Alors que la structure routière, copieusement arrosée par les deniers publics, a été profondément modifiée, la SNCB - c’est bien connu - n’a reçu que des broutilles : à peine quelque 2 milliards de ’61 à ’70. Cela devait inévitablement approfondir le fossé qui sépare les besoins du client de l’offre que la Société peut leur faire (infrastructure, horaires, confort). Il est toutefois surprenant de constater que, alors que dans l’ensemble moins de travailleurs voyagent par fer, au contraire le courant de navette en direction de la capitale ne cesse de croître : en 1961, les huit grandes gares de Bruxelles accueillaient quotidiennement 130 000 navetteurs ; en 1974, ce chiffre était passé à 185 000. De tels mouvements de navetteurs aux heures de pointe provoquent, on s’en doute, d’énormes difficultés dans le trafic des trains, qui ne pourraient être résolues que moyennant d’importants investissements.
En guise de conclusion
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la navette suscitée par l’essor de l’industrialisation a connu une croissance extraordinaire, due en ordre principal aux tarifs particulièrement avantageux consentis par les chemins de fer. Cette navette a indiscutablement contribué au développement des secteurs de base de notre industrie, en facilitant le déplacement de la main-d’œuvre.
D’autre part, la plupart des travailleurs qui à l’époque habitaient en dehors des régions industrielles n’étaient pas contraints de s’exiler. Bien que, en soi, la navette ne puisse être considérée comme un bien, elle est peu à peu devenue assez supportable. C’est en tout cas un phénomène que les pays industriels pourront difficilement éluder. Les statistiques nous apprennent d’ailleurs que, pour la période 1961-1970, le trafic de navette s’est accru de 250 000 unités dans notre pays, soit de 19 %, en dépit des efforts des Pouvoirs publics pour créer des emplois à proximité des régions habitées par les travailleurs.
N’est-il pas paradoxal que, au cours de cette évolution, les transports en commun aient « loupé le train » ? Cet état de choses est sans doute imputable aux Pouvoirs publics qui, à une époque où le confort bat son plein et où le client devient de plus en plus exigeant dans ce domaine, se sont montrés pour le moins parcimonieux envers les transports en commun.
Mais nous ne nous lamenterons pas outre mesure, puisque le souci de la préservation du milieu et la crise de l’énergie nous prouvent chaque jour que les transports publics en général, et les chemins de fer en particulier, ont encore une importante mission à remplir.
Pour nous permettre de la faire comme il faut, d’importants investissements seront bien sûr indispensables, ce qui veut dire que dorénavant les Pouvoirs publics devraient s’orienter résolument vers une politique de promotion des transports en commun.
Quoi qu’il en soit, le travailleur de 1975 est indiscutablement mieux traité que celui du début du siècle. Son acheminement prend rarement plus d’une heure, il navette de jour le plus souvent et la plupart du temps la moitié de ses frais de transport est supportée par son employeur.
Source : Le Rail, mai 1975
 Rixke Rail’s Archives
Rixke Rail’s Archives