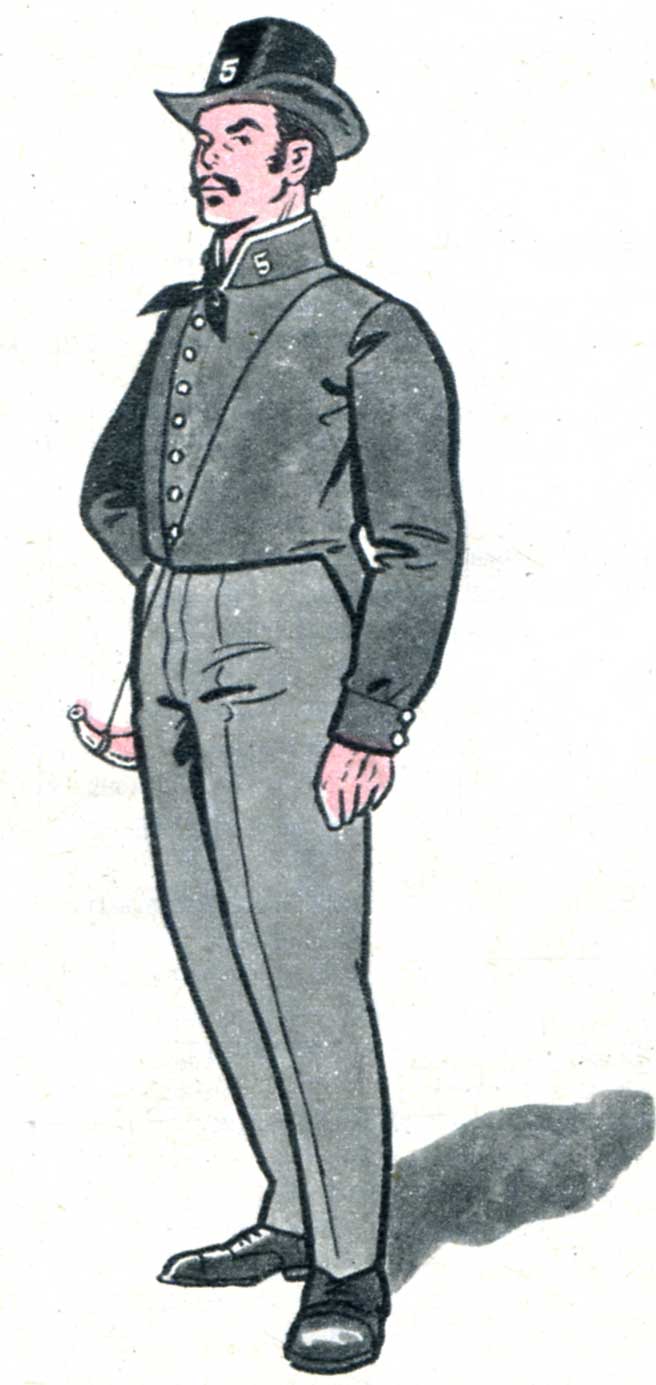Accueil > Le Rail > Poésie - Lecture - Peinture > Une dynastie de cheminots (VI)
 Une dynastie de cheminots (VI)
Une dynastie de cheminots (VI)
J. Delmelle.
mercredi 2 décembre 2015, par
Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]
Mais j’en reviens à mon propos ! En 1852, les wagons sont dotés, depuis peu, de l’éclairage au pétrole. La construction des châssis a été perfectionnée ; la suspension, améliorée. Le progrès est en marche et rien, désormais, ne peut l’arrêter. En 1860, la société Saint-Léonard, de Liège, construit une première locomotive à bogies. On étudie la création de foyers à plus fort rendement de vapeur. Quelques années plus tard, l’utilisation du convertisseur de Bessemer se généralisant, on augmente la pression intérieure des chaudières. La surchauffe est appliquée. La température de la vapeur est portée à 350 et même à 450 degrés, tandis que la pression atteint 18 atmosphères et même davantage. Pour obtenir une meilleure adhérence au rail, le poids des moteurs est augmenté, en rapport avec la puissance qu’ils développent.
Dans le même temps, le réseau s’étend toujours de plus en plus. Celui de l’Etat atteint 863 kilomètres en 1870, tandis que ceux des 39 compagnies concédées totalisent 2.231 kilomètres. Il y a donc, en Belgique, à ce moment-là, plus de 3.000 kilomètres de voies ferrées. L’étendue du réseau, l’interpénétration — si l’on peut dire — des voies ferrées, la multiplication des convois et l’accroissement de la vitesse posent, de façon de plus en plus aiguë, le problème de la signalisation. On s’en était fort peu préoccupé au début, lorsque les trains étaient peu nombreux et ne dépassaient guère 25 kilomètres à l’heure. Le machiniste surveillait la voie devant lui, ralentissait l’allure si c’était nécessaire et, comme les horaires n’avaient pas la rigueur que nous leur connaissons aujourd’hui, pouvait se permettre de stopper et d’immobiliser son train pendant un bon bout de temps... pour laisser passer un troupeau de vaches ou de moutons. La nuit, la dernière voiture du convoi était munie, à l’arrière, d’une lanterne rouge. C’était là une précaution que l’on considère encore aujourd’hui comme opportune. Déjà, vers 1845-1850, la nécessité de doter le réseau d’une signalisation de nature à éliminer certaines causes d’accidents avait été soulignée par d’aucuns. En 1848, à la suite d’un accident, un journaliste faisait remarquer que, dans un grand nombre de cas, les faits que l’on a à regretter auraient pu être évités. Il était possible de les prévenir, soit par la mise en service d’une signalisation appropriée, soit — par exemple — en dotant les mécaniciens de... longues-vues leur permettant d’observer avec soin la ligne, tant en avant... qu’en arrière, pour découvrir de loin soit les rails déplacés, soit tout autre obstacle de nature à gêner la marche du convoi. Dès que ces obstacles auront été signalés, écrivait-il, des freins puissants permettront d’arrêter les convois dans leur périlleuse carrière. L’ouverture et la fermeture des rails mobiles, ainsi que des aiguilles, devraient être indiquées par des disques visibles, et visibles de loin, en sorte que, dans le cas même où un employé négligerait son devoir, ce devoir fût signalé à ceux qui y sont le plus intéressés : ce moyen préventif vaudrait certainement mieux que les punitions infligées lorsque le mal est fait. La nuit, ces signaux seraient éclairés, et des fanaux seraient également établis aux passages de niveau et autres points par où des bestiaux et des gens peuvent s’introduire sar la ligne et former un obstacle sur la voie. Il est nécessaire aussi que, quand un accident survient dans le convoi même, comme une voiture qui prend feu, ou quand les voyageurs aperçoivent eux-mêmes quelque obstacle ou quelque danger, il y ait quelque moyen de communiquer avec le mécanicien... Est-ce pour répondre à ce souhait que l’on introduisit un jour, longtemps après, les signaux d’alarme à poignée ? Ce n’est pas sûr. Quoi qu’il en soit, vers 1850, un système de signalisation est établi. Il ne cessera d’être étendu et perfectionné. En 1874, on commencera l’installation du bloc-système, à signaux enclenchés par l’électricité. Des signaux à palettes le jour, à feux de couleurs la nuit, préviendront le machiniste que la voie est libre ou fermée. Une palette ou un feu de sémaphore, ou bien la position intermédiaire de la palette, lui annoncera que le signal suivant est ouvert ou fermé. Il aura le temps, dès lors, de prendre toutes ses dispositions en vue du ralentissement ou de l’arrêt de son convoi. Des balises, ces pièces de bois peintes en blanc et barrées d’un ou de plusieurs traits noirs, de un à cinq, placées verticalement ou horizontalement, lui signaleront, en outre, qu’il arrive en vue d’un signal avertisseur ou de bloc à trois positions. D’autres innovations succéderont à celles-là : sémaphores « chandeliers », signaux spéciaux, etc... Une visite à la cabine de signalisation d’une grande gare est extrêmement édifiante. Même en cas d’erreur ou de faute des signaleurs, une rencontre de trains est devenue quasiment impossible. En plus du langage des signaux visuels, il y a celui des coups de cornet et des coups du sifflet à vapeur : un coup bref pour la mise en marche, un coup allongé pour l’annonce d’entrée dans un tunnel, un coup allongé soutenu pour l’avertissement des voyageurs dans les gares, plusieurs coups brefs répétés pour donner l’alarme. Ce genre d’alphabet morse est condamné par l’électrification du réseau. Les perfectionnements de la signalisation visuelle — favorisée, notamment, par le télégraphe, le téléphone et la radio — l’ont rendu superflu.
C’est dans quantité de secteurs différents du vaste domaine ferroviaire que la révolution, déjà commencée en 1852, devait se poursuivre et se développer. Elle devait s’opérer, notamment, au bénéfice du confort des voyageurs, qui, vers 1875, disposèrent, sur certaines lignes tout au moins, de « chaufferettes », rudimentaires certes, mais extrêmement appréciées par périodes de grands froids. Ces « chaufferettes » étaient des sortes de bouillottes en bois garnies de zinc. On les remplissait d’eau bouillante et on les déposait sur le plancher des voitures ; dans toutes les classes. Certaines gares étaient munies d’installations spéciales pour le remplissage de ces « chaufferettes » et pour leur renouvellement. Le système demeura en usage pendant une bonne trentaine d’années avant d’être remplacé par le chauffage à vapeur. Une conduite partant de la locomotive distribuait, dans chaque compartiment muni de radiateurs réglables, la précieuse vapeur, source de chaleur.
Une autre innovation d’importance devait être introduite durant le laps de temps considérable — 34 ans ! — passé par Joseph Barbeaux aux chemins de fer : la voiture-lit, que la voiture-restaurant devait suivre de quatre ou cinq années. C’est à un ingénieur belge, Georges Nagelmackers, que revient le mérite d’avoir doté le réseau européen des premières « bonbonnières à roulettes ». En 1871, voyageant aux Etats-Unis, il s’était enthousiasmé pour la réalisation d’un de ses confrères de Chicago, Georges Pullman. Celui-ci avait imaginé d’insérer, dans les convois à longue distance, quelques voitures de luxe comportant un certain nombre de « cellules » fermées, aménagées à la façon de petites chambres à coucher. Les voyageurs faisant d’interminables parcours avaient, de la sorte, la possibilité de se reposer et n’arrivaient pas, à destination, éreintés, fourbus, moulus. Nagelmackers, avec l’appui du roi Léopold II — toujours soucieux de favoriser le progrès —, fonda à Bruxelles, en 1876, une société au capital de quatre millions de francs. Les premières voitures de la « Société internationale des Wagons-Lits » étaient assez rudimentaires. Montées sur deux essieux, elles comprenaient deux « cellules » donnant sur un couloir conduisant à un cabinet de toilette. Les voyageurs devaient se soumettre aux prescriptions d’un règlement très rigoureux : ne pas fumer entre 23 heures et 7 heures, se déchausser avant de se coucher, etc. Depuis 1876, le confort des voitures-lits a été amélioré au maximum. Les voitures-restaurants, de leur côté, ont été aménagées de façon toujours plus rationnelle. Leur réputation « culinaire » est égale à celle des meilleurs établissements. En 1886, le déjeuner revenait à quatre francs et le dîner à six francs, mais, pour ce prix-là, on servait au client un menu réellement extraordinaire comprenant un potage, des hors-d’œuvre, un poisson, deux plats de viande, un légume, entremets et desserts.
Le « sleeping », plus que le wagon-restaurant, a suscité une abondante littérature. Les écrivains ont fait preuve de beaucoup d’imagination... alors que bien des situations baroques se sont produites dans la réalité. Les contrôleurs des voitures-lits ont tous été témoins de quelques faits amusants, pittoresques, imprévus. L’un d’eux, voici vingt-cinq ou trente ans, avait convoyé la reine de Roumanie et son fils, le futur roi Michel, encore enfant. Dans une cabine voisine de la leur voyageait une femme... se trouvant dans une situation intéressante et qui, pour cette raison, avait été recommandée à son attention. En cours de route, un voyageur affolé vient l’appeler : la dame accouchait ! Le contrôleur se précipita pour lui venir en aide et, dans son trouble, laissa la porte de la cabine ouverte. A un moment donné, se retournant, il aperçut le jeune prince suivant le déroulement des opérations d’un œil particulièrement intéressé. « Espèce de garnement, s’écria-t-il, veux-tu bien disparaître ! »
Ayant entendu crier, la Reine arriva et, sans broncher, prit son fils par la main et l’entraîna dignement loin de cette scène décidément peu banale...
Source : Le Rail, juin 1960
 Rixke Rail’s Archives
Rixke Rail’s Archives