Accueil > Le Rail > Histoire > Le temps de l’horreur
Le temps de l’horreur
A. Lagource.
mercredi 9 avril 2014, par
Les commémorations se suivent, mais leurs couleurs sont bien différentes.
Le mois dernier, nous célébrions, dans l’allégresse, le « cent cinquantième »...
L’événement dont nous avons à nous souvenir pour le coup commande un peu plus de recueillement, puisqu’il s’agit du quarantième anniversaire de la libération des prisonniers de guerre et des détenus politiques. Le huit mai 1945, l’Allemagne nazie - qui avait fait le pari de régler le sort de l’Europe et du monde pour mille ans - a crié pouce et s’est rendue sans conditions. Dès la fin mai et surtout en juin, commencèrent à rentrer au pays les prisonniers : les militaires et les politiques. La joie pour les uns comme pour les autres et, bien entendu, pour leurs parents et leurs amis. On en oubliait presque le prix qu’avait coûté la mégalomanie hitlérienne : cinquante-cinq millions de morts !
Ce furent des retrouvailles émouvantes et parfois dramatiques. J’ai encore présente à la mémoire une scène poignante. Comme tous les matins, je partais au boulot. Comme tous les matins, la jeune bouchère guettait le coin de la rue qui menait à la gare : si son mari allait revenir là, maintenant... Il avait été mobilisé peu après leurs noces. Il y a des jours où le destin a le cœur à la rigolade : ce matin-là était le bon, et le boucher déboucha du coin de la rue. En pantoufles, la jeune femme courut à sa rencontre pour s’ébouler dans ses bras en pleurant, pleurant, pleurant... Quand elle souleva la tête pour regarder son mari et s’assurer qu’elle ne rêvait pas, on put distinguer au milieu de ces larmes le plus beau sourire du monde. Je pense encore fréquemment au rire de la bouchère, secoué de sanglots : comme à l’image même du bonheur.
Ailleurs, ce furent des enfants et un père qui s’embrassaient sans se reconnaître. Quand ils s’étaient quittés, les uns avaient deux et trois ans, l’autre vingt-cinq. Maintenant ça faisait sept et huit pour les petits, trente pour le vieux ! On a du mal à combler ce vide-là. Et pourtant avec quelle félicité on se remettait à vivre ensemble.
Dans les stalags, les fortunes avaient été fort diverses. Bonne, moins bonne ou mauvaise, c’était selon. De toute façon, l’absence de liberté et l’éloignement suffisaient à leur peine : qu’ils fussent au camp, aux champs ou à l’usine.
Toutes les bornes dépassées
Je ne vexerai aucun prisonnier de guerre en affirmant que, comparé au sort des « politiques », le leur fut, dans l’ensemble, plutôt enviable, qui dépendait de l’armée allemande, dure, draconienne, mais infiniment moins brutale, moins odieuse que les engeances dont relevaient les « politiques » et qui avaient noms : Gestapo et SS...
La Gestapo, c’était la police secrète du Reich. Dans tous les pays du monde, la police secrète a cette réputation de n’être pas regardante sur les moyens. Un interrogatoire peut rarement être confondu avec un dialogue de salon. Mais, avec la Gestapo, toutes les bornes étaient dépassées. Pour elle, d’abord, tout suspect était coupable (donc arrêté). Et toute arrestation impliquait des aveux. On interrogeait en conséquence. Techniques froides et sans pitié ; méthodes vigoureuses ! Les passages à tabac étaient monnaie courante, mais ne constituaient que de modestes zakouskis. On passait vite au solide : on suspendait le prisonnier par les bras, on lui arrachait les ongles, on lui brûlait le corps à l’aide de cigarettes, on lui envoyait des décharges électriques dans ses parties les plus sensibles, on l’immergeait dans l’eau glacée jusqu’aux limites de l’asphyxie, etc., etc. Avec les gestapistes, le Moyen Age avait fait une rentrée en force dans notre siècle, mais il avait raffiné et modernisé ses moyens. Ces sbires avaient leur manière à eux de faire la guerre : sans risques, et en développant jusqu’au délire, les mille et une recettes d’un sadisme sans appel. Torquemada était enfoncé. Ces tortures utilisées par la Gestapo ont laissé de nos jours des traces dans quelques cerveaux malades des nostalgiques de la colonisation et de l’état fort. La violence, hélas ! ça s’apprend ! On sortait rarement intact des mains de ces brutes-là. Rarement innocent aussi.
On aboutissait en taule dans le meilleur des cas. Dans le pire, on était expédié dans un camp, où on passait dans d’autres mains, guère plus blanches : celles des SS. Hitler avait entendu établir son règne et celui de « la race des seigneurs » (en réalité des « saigneurs ») sur un pouvoir militaire impitoyable et d’une cruauté sans précédent. Le fer de lance de ce pouvoir était constitué par un double corps d’élite : la SA (section d’assaut) qui faisait le ménage lors des premiers meetings de cet agitateur de taverne, et la SS. Rapidement, pour des raisons diverses, la SS devint le seul garant de la rigueur hitlérienne. Le 30 juin 1934, le Führer en personne, aidé de la crème de sa SS, procéda à l’élimination physique des bonzes de la SA au cours d’une nuit sanglante, qui est restée dans l’histoire sous l’appellation dépourvue d’équivoque de « Nuit des longs couteaux ». La SS avait les mains libres. Dans ce beau monde, les loups se mangeaient donc entre eux. On était prévenus (enfin, on aurait dû...). Ce fut la SS qui fournit le personnel d’encadrement des camps de concentration (inaugurés en 1933, à Sachsenhausen) qui se mirent à proliférer par la force même des choses : ils étaient destinés à l’internement de tous les opposants au régime, mais aussi des Juifs, des Slaves, des Tziganes... des malades physiques, mentaux, des fous, etc. L’idéologie (sic) nazie était fondée sur la croyance démente en la pureté exclusive de la race germanique. Ce racisme élémentaire rejetait dans les soutes de la sous-humanité les Israélistes, les Slaves, les Gitans... Il faudrait s’en gausser s’il n’y avait lieu de s’en révolter : pour les Hitler, Himmler, Goering et autres gugusses, des gens comme Charlie Chaplin, Albert Einstein, Marcel Proust, Fedor Dostoïevsky, Django Reinhardt, constituaient des rebuts d’humanité...
Goering prétendait qu’il avait calqué l’organisation de ses camps sur celle des camps britanniques installés lors de la guerre des Boers. Il est de fait qu’au début ils ne furent que des camps de concentration, d’internement, où la peine du fouet était de rigueur. Certes, il arrivait qu’on y mourût de faim ou d’épuisement ; rarement de sévices. Himmler, chef suprême de la SS, régnait en maître sur les camps. Il avait en Heydrich un second fort ambitieux.
L’extermination
L’invasion de la Pologne, puis celle de l’URSS provoquèrent une mutation dans la vocation des camps, qui devinrent des camps d’extermination.
Ce mot, à lui seul, faisait les délices des aristocrates du nazisme : extermination ! La chose allait pour ainsi dire de soi : les conquêtes de l’Est avaient sérieusement augmenté le contingent d’Israélites et de Slaves.
Bien évidemment, lors des campagnes de Pologne et surtout de Russie, les groupes d’action SS s’étaient fait la main en exécutant sommairement, et en quelques mois, plus ou moins un million de Juifs sur place, en signant leurs forfaits (il y a des procès-verbaux fort éloquents). Mais il en demeurait encore tellement !
C’est alors que fut mise sur pied « la solution finale », c’est-à-dire l’extermination des « sous-hommes ».
C’est donc à la suite d’une sursaturation des camps - inscrite dans la logique des conquêtes et du racisme des gentilshommes nazis - que fut perpétré le génocide le plus monstrueux de toute l’histoire de l’humanité. Ce génocide ne fut pas le fruit d’une improvisation mais la conséquence d’un raisonnement froidement élaboré. Exterminer, c’était bien joli : mais il fallait trouver un moyen massif et expéditif pour le faire. Le principe de la chambre à gaz donna toutes les satisfactions dans ce domaine. A Auschwitz, on liquidait deux mille personnes à la fois.
Le catalogue de l’horreur
Tout le monde n’était pas promis d’emblée à l’asphyxie. Les sujets en bonne santé étaient mis au travail dans le camp ou vendus par la SS comme main-d’œuvre à l’industrie (Krupp, par exemple), ce qui leur accordait de toute façon quelque temps de sursis. Ce sursis n’excluait bien entendu pas les sévices, tels que bastonnades, flagellations, etc. Par contre, les malades, les difformes, les vieillards, les enfants en-dessous de quatorze ans, les mères qui les accompagnaient, les femmes enceintes, les hommes trop malingres pour travailler... tous ceux-là avaient leur destin tout tracé : la chambre à gaz à brève échéance.
Qu’on fût à Dachau, à Buchenwald, à Mauthausen, à Auschwitz, à Treblinka, à Bergen-Belsen, à Flossenburg, à Ravensbruck.... bref dans n’importe quel camp, le traitement était sensiblement le même. Les nazis étaient gens d’ordre.
Il y eut pourtant un hic. Ces exterminations massives laissaient des traces quelque peu gênantes. Les fours crématoires apportèrent une solution à ce problème. Dès qu’il n’y avait plus signe de vie dans la chambre à gaz, des SS y pénétraient, prélevaient les dents en or sur les cadavres, coupaient la chevelure des femmes, après quoi, à l’aide de pinces prévues à cet usage, les corps étaient transportés dans les fours crématoires.
Ni vu, ni connu (hormis l’odeur qui empoisonnait l’alentour). Il convient d’ajouter qu’il y avait trois cent cinquante médecins SS qui officiaient à l’intérieur des camps. Quelques-uns d’entre eux se livrèrent sur les prisonniers juifs à des expériences de toutes sortes, dont la plus célèbre demeure celle qui avait pour but la stérilisation en masse qui permettrait d’anéantir la race en une seule génération. On pratiquait des rayons X, on faisait des infiltrations. Les cobayes humains mouraient dans d’horribles souffrances...
Joseph Klek, quant à lui, s’amusait à faire des piqûres de phénol dans le cœur : les spasmes de l’agonie, chez les victimes, lui procuraient des frissons intéressants. Le plus connu de ces « chercheurs » SS fut assurément le docteur Mengele dont la spécialisation était l’étude des jumeaux ; il faisait sur eux des expériences : vivants d’abord, morts ensuite... Il faut arrêter ici ce catalogue de l’horreur.
On se pose aussitôt la question : personne ne réussit à faire connaître au monde cette entreprise crapuleuse ? Si, mais les faits dénoncés étaient si épouvantables que personne en Occident - personne - n’y ajouta foi. Et les Juifs, les Gitans, les Slaves etc. continuèrent d’être gazés et brûlés. Six millions d’après les statistiques les plus crédibles.
Il fallut que cet Occident-là, par l’intermédiaire de ses armées libératrices, eût le nez sur la monstruosité pour qu’il se rendît à l’évidence. La stupeur le disputa à la révolte. La rage se mêla à l’hébétude. Même ceux qui avaient vécu quatre ans sous la botte nazie en demeurèrent sidérés : et pourtant les occupants ne s’étaient nulle part comportés comme des enfants de chœur.
En fait, seuls les films et photos convainquirent le monde qu’on venait bel et bien de toucher le fond même de l’abjection, de l’horreur, de la brutalité, de... d’ailleurs il n’y avait pas de mot pour désigner ça.
On inventa celui de génocide qui est bien poli pour un holocauste aussi abominable.
Puis Nuremberg entérina les faits, où un Rudolf Hoess, par exemple, avoua ses forfaits avec une fanfaronnade (ou une irresponsabilité) éhontée, les appuyant de statistiques précises. Au jour d’aujourd’hui, il arrive que l’un ou l’autre hurluberlu, gêné d’étaler des idées analogues à celles que défendaient les nazis, essaye de clamer que cette horrible histoire n’est qu’une fable inventée par les vainqueurs, avec l’espoir illusoire que, quarante ans après, il ait des chances d’être cru.
Hélas, il y a des preuves des délits, des preuves matérielles : les camps, les fours, les chambres à gaz, etc. Si elles n’existaient pas, l’antisémitisme déclaré des nazis et la disparition de six millions de Juifs ne constitueraient-ils pas à eux seuls une solide présomption à même d’ébranler les pires scepticismes ? Et puis qui, à l’époque, n’a pas rencontré de ces rescapés, de ceux-là qui avaient obtenu un sursis et que l’arrivée des troupes alliées a préservés de l’horreur définitive ! En quelque sorte, des oubliés de la mort !
Ce regard déserté
A l’époque, frais émoulu des humanités, j’exerçais les fonctions (défuntes désormais) d’aide-chef de section dans un arrondissement de la voie, ce qui m’amenait plus qu’à mon tour à déambuler sur les quais de la gare où œuvraient les brigades. C’est là que j’ai vu, de mes yeux vu, de mes propres yeux vu, le premier rescapé de l’enfer. A vrai dire, c’était une femme, mais sa chevelure seule en attestait. Pour le reste, du diable si on pouvait donner un sexe à cette créature, flottant dans le droguet rayé des concentrationnaires. A l’âge qui était le mien alors, on aborde, souvent inconsciemment, les personnes du sexe avec quelque arrière pensée de séduire, de faire le joli cœur. Pas question de cela, quand je me trouvais devant cette épave.
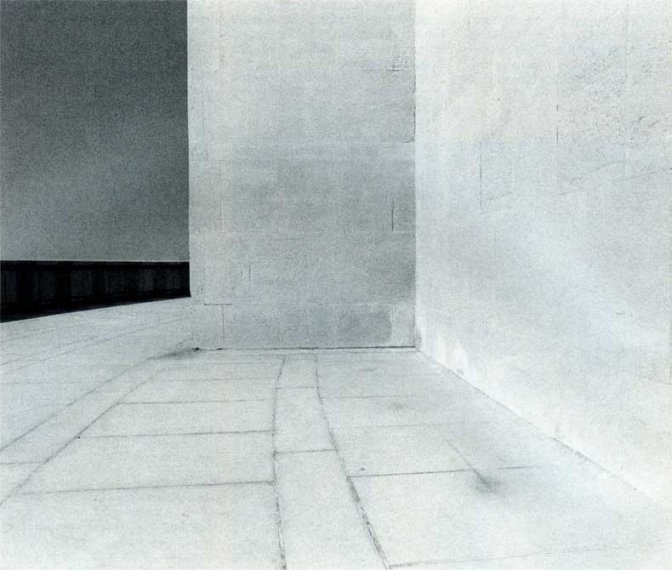
L’amplitude du vêtement empêchait d’inventorier l’état de ce corps féminin « qui tant est tendre », mais cette face émaciée qui le surmontait en laissait imaginer la maigreur, l’étisie, le délabrement.
Le visage décharné ne devait pas être celui d’une personne d’âge et pourtant, des commissures des lèvres au front, il était ridé comme une de ces poires qu’on nomme bergamotes, et pourtant les cheveux qui l’auréolaient farouchement accusaient un grisonnement maladif.
Mais tout ça n’était rien, comparé au regard.
C’était un regard qui en un instant vous vieillissait de vingt ans. Aux abois derrière des paupières lourdes, il ne semblait plus habité par rien si ce n’est par une lassitude sans nom, par une tristesse d’au-delà le désespoir. Il y avait encore au fond de ces yeux comme l’éclat d’une flamme minuscule (mais il fallait les scruter très loin) qui disait que ces yeux-là, il n’y a guère, avaient utilisé les mille modulations d’une belle sensibilité. Mais là, dans cette face vidée de sa substance, au fond de ses orbites démesurées, au-dessus de cet uniforme dégradant, ils semblaient vides de toute charge d’humanité. Impossible de planter mes propres yeux dans ce vide-là ! On a souvent parlé de déshumanisation à propos des nazis. Ce regard déserté disait exactement ce que le mot recouvre d’ignominie, d’horrible et d’irréversible.
Je tentais bien d’engager la conversation avec ce spectre dont je me demandais si, en l’oubliant, la mort lui avait vraiment fait un cadeau : « D’où venez-vous ? » Réponse d’une voix éteinte « Mauthausen ! » Une question idiote de ma part : « C’était dur ? ». Une tentative de sourire, avorté en rictus : « Vous ne pouvez pas savoir ».
Ce fut tout.
J’ai croisé sur les quais par après des dizaines de ces fantômes.
A chaque fois, c’était le même regard de bête traquée, ou plutôt non, la même absence de regard qui m’interdisait d’aller plus loin dans toute investigation.
« L’homme est un loup pour l’homme » a observé Plaute avec désabusement. Le nazisme a prouvé que cette constatation est bien en dessous de la vérité !
Source : Le Rail, juin 1985
 Rixke Rail’s Archives
Rixke Rail’s Archives